La première erreur de Lordon tient, selon moi, à un défaut majeur de la méthode : partir d’une définition abstraite du racisme de laquelle est soustraite toute référence aux classe sociales et à l’Etat[1]. D’abord séparé de tout, le racisme pourra difficilement se combiner avec une quelconque détermination sociale, économique ou politique, aussi bien hier qu’aujourd’hui. En posant les oppressions raciales et masculines comme extérieures au capitalisme (qui les utilise par « opportunité »), Lordon se heurte à des difficultés insurmontables[2] lorsqu’il cherche à faire tenir ensemble l’idée d’une égalité des luttes et celle d’une hiérarchie des dominations où la classe prédomine (en conformité avec sa thèse d’une pure contingence des rapports de domination raciste).
Le racisme n’est pas contingent mais nécessaire au capitalisme
Or, une hypothétique « rencontre contingente » entre le racisme et le capitalisme ne dit rien de la nécessité du racisme pour le fonctionnement du capitalisme. Si l’on tient pour contingents tous les facteurs que ce mode de production « a rencontrés », il ne reste plus grand-chose pour décrire un rapport capitaliste « pur » avec son mode de domination « à lui ». Le capitalisme n’a pas inventé grand-chose et sur son chemin il a trouvé la marchandise, la monnaie, l’Etat, la rente foncière, la plus-value, le profit, le commerce, la banque, la guerre, etc. Des réalités qui parfois le contrarient au plus haut point, comme la monnaie qu’il ne cesse de chasser[3], ou bien l’Etat qu’il voudrait réduire désormais à coups de tronçonneuse ! Il serait toutefois difficile d’admettre que « monnaie », « Etat » ou « guerre » ne seraient pas nécessaires au fonctionnement du système.
Au lieu de partir d’une définition abstraite, Lordon aurait pu regarder attentivement à quel moment le racisme est apparu. Il aurait vu alors que ce rapport de domination n’est nullement nécessaire aux premières formes du capital (commercial et usuraire), et qu’il le devient précisément au moment où le capitalisme se constitue comme système ; au moment où le capital industriel s’empare des moyens de production et jette par millions les êtres humains « sous les roues de son Jaggernaut[4] » ; et davantage encore au moment où le capital financier met le globe entier en coupe réglée.
Lordon connaît évidemment le rôle du colonialisme dans la genèse du capitalisme (autrement nommée « accumulation primitive ») avec ses « procédés idylliques »[5]. Il sait bien que « c’est l’esclavage qui a donné leur valeur aux colonies, (que) ce sont les colonies qui ont créé le commerce de l’univers, (que) c’est le commerce de l’univers qui est la condition de la grande industrie[6] ».
Fondation du capitalisme sur l’ordre colonial
Il manque pourtant l’occasion de comprendre comment lors de ce long processus le capitalisme a fabriqué la domination de race, loin de l’avoir trouvée toute prête[7]. Car il ne s’agit pas d’une « rencontre », mais d’une fondation, de celle qui a lié inextricablement et pour toujours racisme et capitalisme. Dès que la production sort de son cercle étroit pour viser le marché, note Marx, « alors on voit, sur les horreurs barbares de l’esclavage, du servage, etc., se greffer l’horreur civilisée du surtravail[8]». Ce n’est pas un hasard si Colbert rédige la première version du Code noir tout en organisant le commerce mondial du textile.
Mais je voudrais surtout revenir sur l’illusion que le capitalisme pourrait tourner « sur un seul cylindre ». Elle prend sa source dans l’idée que les abominations de l’expansion commerciale et coloniale européenne appartiennent à un passé dépassé. Une des beautés du système est d’avoir effacé toute trace infâme de sa genèse, pour se présenter sous le jour incolore de la nécessité, loin de toute morale. N’est-ce pas d’ailleurs le secret de « l’innocence blanche » ?
Une fois lancé en effet, le système semble rouler tout seul grâce à un mécanisme purement économique qui efface sa genèse « extra-économique »[9]. C’est sa grandeur et la source de sa puissance. Merveilleux système où la contrainte paraît si naturelle qu’elle devient acceptable, où le fusil dans le dos du travailleur est tout aussi invisible que la chaîne qui l’attache à la classe capitaliste[10]. Et qui semble donc tourner tout seul, sur un seul cylindre, par le miracle de la seule et pure contrainte économique, de ce que Marx appelle le « double moulinet » du procès de production lui-même[11] (la force de travail sort du procès de travail aussi nue qu’elle y est entrée, c’est-à-dire toujours dépourvue des moyens du travail, tout en ayant laissé dans les mains du capitaliste de quoi être rachetée dès le lendemain).

L’introuvable prolétaire abstrait
Cette spécificité historique du capitalisme, où la dépendance du travailleur libre ne résulte pas d’un rapport politiquement et socialement fixé au préalable[12], peut offrir l’illusion d’avoir affaire à un prolétaire dépourvu de toute qualité et de toute détermination sociale, culturelle, sexuelle et politique. C’est vrai en un sens, car ce n’est pas en tant que jeune, femme, blanc ou noir que le travailleur produit de la plus-value, mais en tant que prolétaire.
Mais en un sens seulement. Car il n’y a pas deux prolétaires, l’un qui serait un pur créateur de la plus-value, et l’autre qui exercerait tel métier ou serait de telle « race ». Parce qu’il n’y a pas deux sortes de travail, le travail abstrait, dépourvu de toute qualité, dont Marx a livré le secret en tant qu’il est créateur de la valeur, et le travail concret, tel métier, telle qualité du prolétaire. C’est le même travail.
Nous touchons ici à la seconde faille du raisonnement de Lordon, qui semble ne pas saisir le sens de l’abstraction chez Marx. Le travail abstrait que Marx dégage de la gangue du travail concret pour révéler le secret de la création de valeur, ce travail abstrait n’est pas seulement un concept désincarné mais une réalité sociale. Avec le capitalisme, le travail productif tend à prendre la forme concrète du travail abstrait[13]. Si les déterminations concrètes du travail et du travailleur n’expliquent pas par elles-mêmes le mécanisme de l’accumulation du capital et de l’exploitation de la force de travail, il faut pourtant nécessairement une organisation de classe concrète pour que cette exploitation se produise[14]. Le fait qu’elle n’apparaisse pas dans Le Capital entraîne bien des malentendus.
Pourtant Marx est d’entrée de jeu explicite lorsqu’il annonce qu’il va exposer les lois économiques elles-mêmes, et non les antagonismes sociaux qu’elles engendrent[15]. «J’étudie les conditions d’existence économiques (nous soulignons) des classes sociales[16]» précise-t-il, et non les conditions de vie et de lutte ni les déterminations concrètes de la classe.
La concurrence, relation capitaliste fondamentale
Il n’est d’ailleurs guère question nommément de classes sociales dans Le Capital[17], alors qu’elles sont bien entendu partout. On ne les trouvera pas non plus dans l’épaisseur sociale qu’Engels avait mise à nu dans tous ses détails[18]. Même dans le seul chapitre où il va explicitement parler de la lutte des classes (à propos de la journée de travail[19]), Marx dessine finalement un portrait stylisé du prolétaire, qui « n’est plus ici que du temps de travail personnifié » écrit-il lorsqu’il veut illustrer « l’horreur du surtravail, ce produit de la civilisation »[20]
Mais dès que l’on « s’élève de l’abstrait au concret », pour reprendre sa formule toute hégélienne, on trouvera nécessairement les relations historiques, culturelles, sexuelles, politiques sans lesquelles l’organisation de classe concrète serait impossible[21]. Or cette organisation a une base matérielle, économique, qui structure toute l’activité du système sous la forme de la concurrence de tous contre tous, des capitaux entre eux comme celle des travailleurs. Tel est le mode de vie propre à la civilisation capitaliste[22]. L’arme absolue de la concurrence, c’est l’armée industrielle de réserve avec les différentes figures de la surpopulation (les chômeurs et les précaires, pour le dire rapidement). Il suffit de regarder les catégories qui y sont les plus représentées pour voir comment fonctionne la concurrence, avec « l’âgisme », le racisme et le sexisme[23].
Qu’est-ce qui fait la force de la concurrence, que les travailleurs ne cessent de vouloir dépasser en se constituant en classe ? C’est l’illusion qu’elle est produite par la qualité propre de tel ou tel, selon sa compétence, son sexe, son âge, sa région ou son origine. L’assignation sociale dans telle catégorie se donne alors à voir comme naturelle. La concurrence semble résulter de la confrontation entre catégories pré-existantes, alors que c’est la stratification politique et sociale du marché du travail qui explique la distribution des salaires, et non l’inverse. Les « politiques d’emploi des jeunes » par exemple, ont conduit à maintenir une majorité de jeunes dans la précarité et à faire de leur salaire un simple tarif[24]. Dès que les immigrés ont conquis des droits égaux aux nationaux (y compris celui d’être électeur et éligible dans les élections professionnelles), l’Etat a créé une nouvelle catégorie : le « sans papier ».
La hiérarchisation raciale s’inscrit « naturellement » dans la stratification sociale de la concurrence. Car il est revenu à l’Etat-nation impérialiste d’avoir importé le rapport de domination raciste, qui a ravagé la planète, à l’intérieur de la métropole, pour y forger l’Etat racial moderne. La xénophobie et le racisme sur le sol national, telle est sa marque[25]. Sous l’Ancien Régime, un esclave posant les pieds en France était immédiatement affranchi et jouissait des mêmes droits, fussent-ils limités, qu’un Français, alors qu’un sans-papier est aujourd’hui privé de droit, y compris de se marier. Napoléon III a protégé les citoyens allemands résidant en France lors de la guerre contre Bismarck – alors qu’en 1914 et 1939 les Allemands étaient internés par l’Etat français et que les USA jetaient les Japonais dans des camps au lendemain de Pearl Harbour.
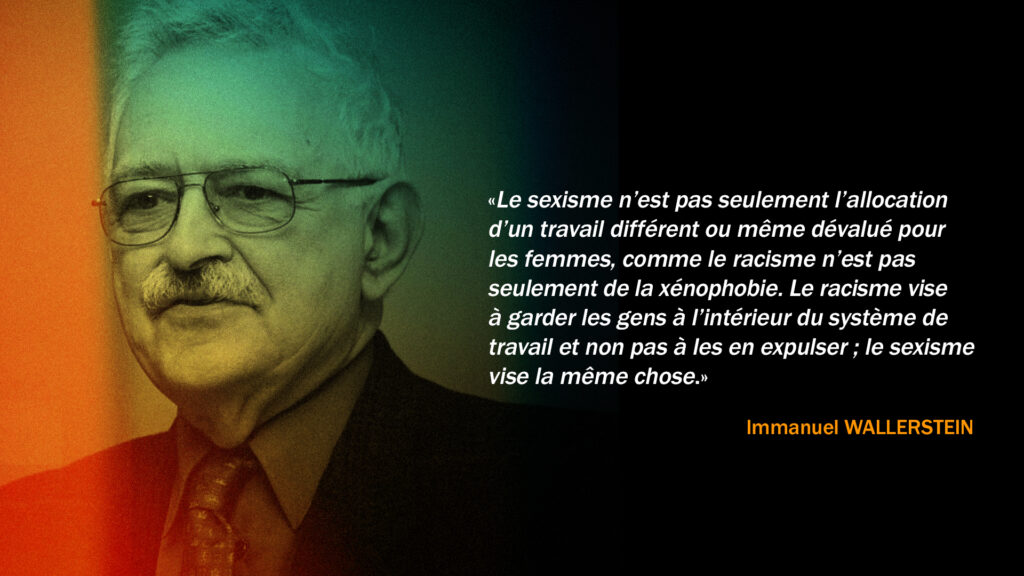
Exclure et inclure d’un même mouvement
Le concept d’ethnicisation de la force de travail, proposé par Immanuel Wallerstein, rend bien compte de cet ancrage de la hiérarchisation raciale dans le phénomène universel de la concurrence. Les catégories raciales présentent l’avantage d’être aussi fluides que celles fabriquées par et pour la concurrence[26]. Wallerstein conclut très justement : « Le sexisme n’est pas seulement l’allocation d’un travail différent ou même dévalué pour les femmes, comme le racisme n’est pas seulement de la xénophobie. Le racisme vise à garder les gens à l’intérieur du système de travail et non pas à les en expulser ; le sexisme vise la même chose» [27]. Comment garder ce qu’on exclut, c’est bien là tout l’effrayant dessein contradictoire de la machine capitaliste avec son cortège de souffrances. Comment garder les immigrés en les noyant dans la Méditerranée et en les parquant dans les centres de rétention avant que les survivants ne construisent nos villes, comment garder les enfants du peuple à l’école en les maintenant dans l’ignorance, comment conserver la force de travail vigoureuse en ruinant sa santé et le système public qui la soigne, etc. Certains groupes subiront davantage les situations les plus rudes, soit temporairement (les jeunes), soit de manière permanente (les femmes, les « racisés »).
C’est ici que la question de la consubstantialité prend sa dimension stratégique. La thèse de l’extériorité du rapport de domination raciste peut conduire à réduire la lutte antiraciste à une simple lutte contre les discriminations et à traiter le racisme en acte comme un épiphénomène, un problème à part. Au contraire, la consubstantialité, qui trouve son expression dans le concept d’ethnicisation de la force de travail, permet de débusquer et de combattre les formes invisibles de la discrimination souvent passées sous silence (ce qu’on appelle le « racisme structurel »). On pourra alors éviter une lutte abstraite « qui ne prend pas la mesure de la consistance proprement raciste des discriminations, à savoir la production et la reproduction d’un rapport social de domination qui imprègne et structure la société dans son ensemble », comme l’écrivaient De Rudder et ses camarades[28].
La compréhension du rôle des discriminations raciales dans la construction des discriminations sociales de classe est le fruit naturel de la thèse de la consubstantialité, qui permet de dépasser la séparation des luttes, j’allais dire leur « cylindrage », dont le mouvement ouvrier pâtit tellement depuis un siècle. Dès qu’on laisse de côté ou que l’on tolère les discriminations légales (par exemple la préférence nationale dans l’emploi et dans l’aide sociale, la loi de 2004 sur les signes religieux), la lutte contre les discriminations invisibles, quotidiennes et illégales n’a aucune chance d’aboutir.
Le danger de la « non-consubstantialité » est d’isoler des catégories discriminées, de les traiter à part (ce que même l’Etat peut faire avec sa désignation institutionnelle des discriminations qu’il prétend combattre), ce qui débouche sur le problème insoluble de la coordination des luttes.
Au-delà de la critique des positions du camarade Lordon (est-il besoin de préciser que nous sommes du même côté de la barricade ?), ces quelques lignes se veulent un plaidoyer pour faire face à l’urgence. Les digues qui pouvaient encore contenir certaines pratiques de l’Etat racial s’effondrent les unes après les autres sans que se construise le grand mouvement d’opposition requis à l’échelle nationale. Les sans-papiers sont menacés dans leur vie et leur santé, les préfectures fabriquent chaque jour des dizaines de milliers de sans-papiers en bloquant les renouvellements de cartes de séjour, l’arme de la laïcité étend son champ d’action (sport, sorties scolaires), les fondements de la justice des mineurs sont atteints de façon à faciliter davantage encore la chasse aux jeunes migrants ou d’origine immigrée, les pratiques de discrimination raciste s’étalent en pleine lumière.
Oui, il y a urgence à fusionner les luttes.

Pour prolonger
- Du capitalisme, du racisme et de leurs rapports (émission des 10 ans avec Houria Bouteldja et Frédéric Lordon
- Que faire de la race ? Aux sources avec Sylvie Laurent et Loïc Wacquant
[1] « Le racisme est l’infériorisation d’un groupe humain par un autre, la dégradation de ce groupe dans l’ordre de la dignité humaine ».
[2] Longuement exposées dans le livre Figures du communisme, La fabrique 2021, où est publiée la lettre de Felix Boggio Éwanjé-Épée qui sert de prémisse à la controverse sur la consubstantialité entre racisme et capitalisme.
[3] Au point de rêver d’un marché empli de bitcoins, de $Trump et de $Melania !
[4] Le Capital, Livre I, Editions sociales 1950, tome 3 page 88 (ou édition 2022, page 627).
[5] « La découverte des contrées aurifères et argentifères de l’Amérique, l’extermination et l’asservissement de la population indigène, son ensevelissement dans les mines, les débuts de la conquête et de la mise à sac des Indes orientales, la transformation de l’Afrique en garenne commerciale pour la chasse aux peaux noires, voilà de quoi est faite l’aurore de l’ère de la production capitaliste », Le Capital, Livre I chapitre XXIV, Editions sociales 2022, page 724.
[6] Misère de la philosophie, Œuvres, Pléiade, tome 1 page 80.
[7] De nombreux ouvrages traitent de ces questions. Voir par exemple : Theodore W. Allen, The Invention of the White Race, London, Verso Books, 2012 (version numérique disponible) et Eric Williams, Capitalisme et esclavage, Présence Africaine, 1968.
[8] Le Capital, Editions Sociales, 2022, tome 1, page 230.
[9] Voir Grundrisse, Editons sociales 1980, tome 1, pages 425-426. Les conditions de la genèse apparaissent comme le résultat de l’existence présente du système.
[10] « Le travailleur appartient en fait à la classe capitaliste, avant de se vendre à un capitaliste individuel », Le Capital, Editions Sociales, tome III pages 19-20.
[11]Ibid.
[12] « La contrainte ne repose plus sur un rapport personnel de domination et de dépendance, mais uniquement sur les différentes fonctions économiques », Un chapitre inédit du Capital, 10/18, 1971, page 195.
[13] Faire abstraction de la valeur d’usage n’est pas seulement un problème de méthode, elle se produit dans la réalité, dans l’échange même des marchandises (Le Capital, tome 1 page 53). De même, l’effort d’abstraction pour homogénéiser le travail (le travail complexe ramené au travail simple, les différents travaux ramenés à un travail social moyen) afin de comprendre comment il crée la valeur sociale, est une nécessité méthodologique mais aussi une réalité concrète. L’échange marchand place sur un pied d’égalité les produits des travaux les plus divers, en faisant abstraction de leur inégalité réelle (ibid. page 85). Sur cette abstraction réelle, voir le commentaire d’Alain Bihr, La logique méconnue du « Capital », Editions Page Deux, 2010, pages 18 sq.
[14] De même, le rapport concret et physique entre les deux secteurs de la production (moyens de production et de consommation) est nécessaire au système, alors qu’il n’explique en rien par lui-même la production de valeur et de plus-value (voir Livre II du Capital).
[15] Préface à l’édition allemande, Le Capital, Editions sociales 1967, Livre I, tome 1, page 18
[16] Préface à la Contribution à la critique de l’économie politique, Editions sociales 1957, page 3.
[17] L’ultime chapitre s’intitule « Les classes », mais hélas le manuscrit de Marx s’interrompt au bout de deux pages (chapitre LII de la septième section du livre III).
[18] Engels, La situation de la classe laborieuse en Angleterre, 1844.
[19] Chapitre IX de la troisième section du livre I, Editions sociales, 1967, tome 1 pages 227-296.
[20] Op. cit., Pages 239 et 232.
[21] Voir Himani Bannerji Building from Marx: Reflections on “race”, gender and class, http://www.davidmcnally.org/wp-content/uploads/2011/01/bannerji.buildingfrommarx.pdf
[22] Dans l’ouvrage précité Figures du communisme, Lordon perçoit bien que la concurrence est la base matérielle du système, mais il ne pousse pas l’analyse jusqu’au bout pour y déceler la nécessité du rapport racial.
[23] Pour voir comme le chômage a été inventé au moment où se constituait l’Etat impérialiste, voir deux ouvrages : Christian Topalov, Naissance du chômeur 1880-1910, Albin Michel 1994, et M. Mansfield, R. Salais et N. Whiteside, Aux sources du chômage, 1880-1914, Belin, 1994. Précision : une réserve de main-d’œuvre est « spontanément » produite par le procès d’accumulation capitaliste et est en même temps une condition de ce procès. Ce n’est donc pas la surpopulation qui est « inventée », mais les catégories (sociales et juridiques) de « chômeurs » et de « précaires » destinées à discipliner les travailleurs, aussi bien en emploi que sans emploi, et à organiser la concurrence entre eux.
[24] Si c’était la concurrence qui fixait les salaires, les jeunes devraient gagner davantage que leurs aînés, puisqu’ils sont plus diplômés.
[25] Notamment avec l’invention de la citoyenneté sur une base nationale : voir G. Noiriel, Réfugiés et sans papiers, la République et le droit d’asile, XIXe-XXe siècle, Hachette 1998.
[26] Les Italiens, massacrés dans le pogrom d’Aigues-Mortes en 1893 sont devenus de légitimes citoyens européens et n’ont plus à montrer patte blanche
[27] Etienne Balibar et Immanuel Wallerstein, Race Nation Classe, les identités ambiguës, Editions La Découverte, 1990, page 50.
[28] Véronique De Rudder, Christian Poiret, François Vourc’h, L’inégalité raciste : l’universalité républicaine à l’épreuve, PUF, 2000, page 186. Cette équipe de l’URMIS a été pionnière dans la mise en évidence de l’ethnicisation des rapports sociaux.

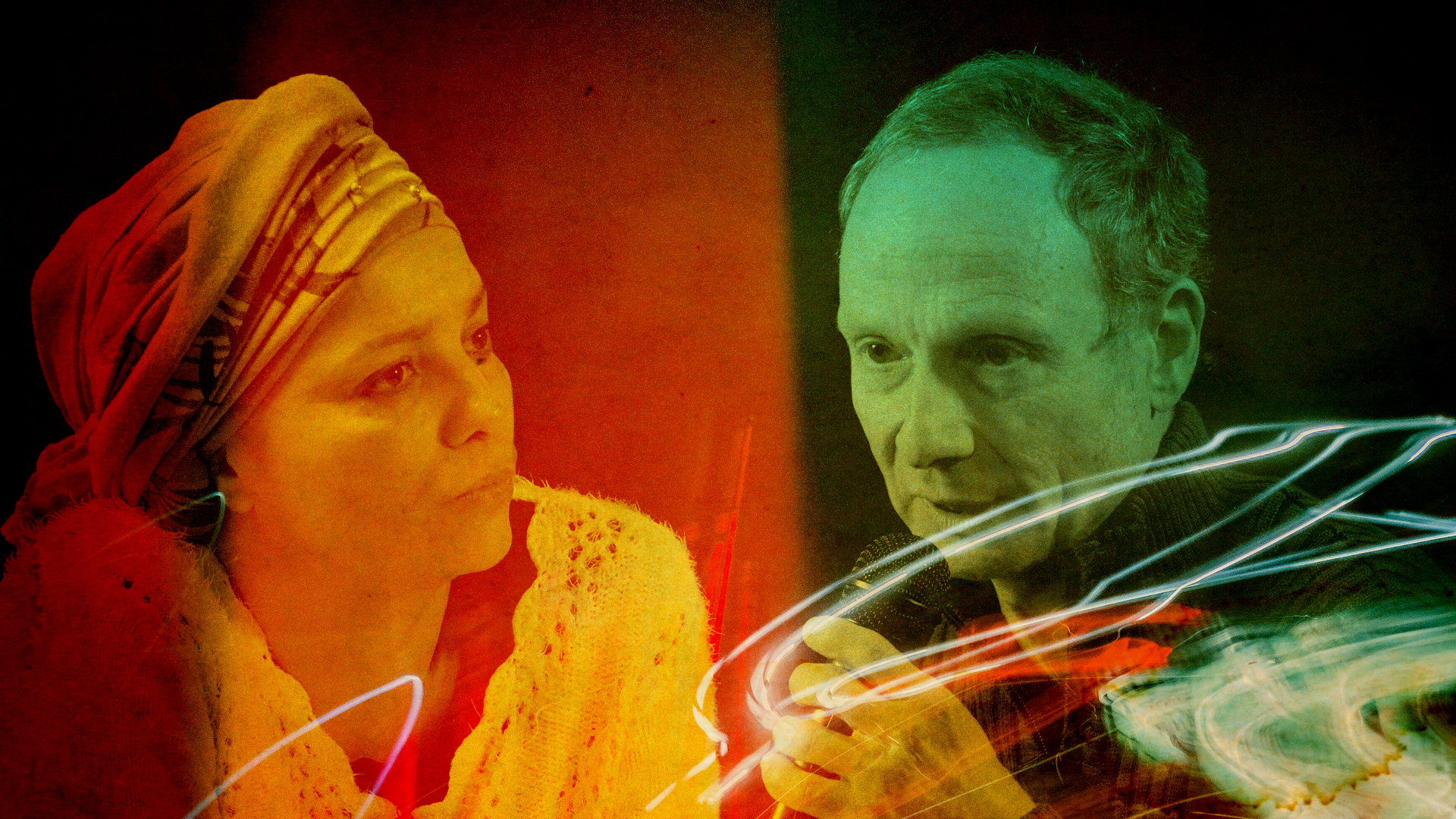
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.